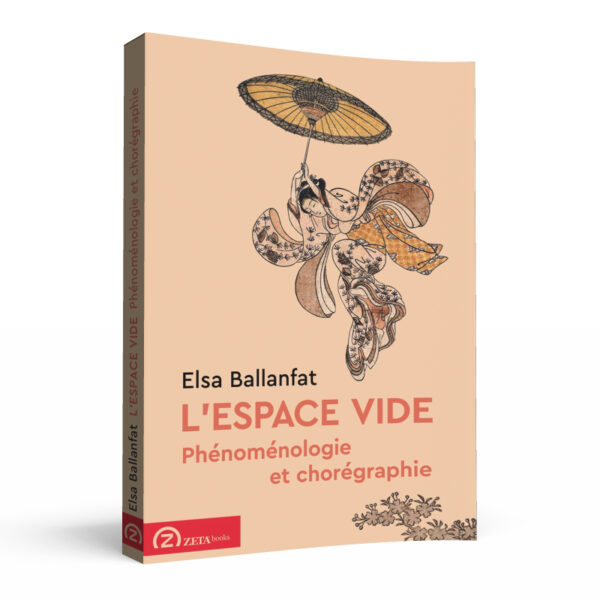Elsa Ballanfat, L’Espace vide. Phénoménologie et chorégraphie, Bucarest, Zeta Books, 2021, 460 p., 24 € .
Plutôt que de parler du vide, parlons concrètement d’espace vide : un espace vide ou plutôt vidé de ce qui empêche d’en faire l’expérience, un espace paradoxal, puisque à la fois visible et invisible, sensible et insensible, vu par lui-même et par contraste. Un espace qui très significativement est celui de la chorégraphie, quand celle-ci n’est plus centrée sur « le corps que j’ai » et sur le corps en mouvement, mais pense l’espace « depuis lui-même ». Un espace auquel l’expérience commune prête rarement accès. Baudelaire, voulant « le vide, et le noir, et le nu », ne fait-il pas exception ? On peut se poser avec Elsa Ballanfat cette question : « Qui a déjà posé son regard non pas sur les étals d’un commerçant, mais sur l’espace vide, invisible, qui apparaît avec, et par contraste, la couleur des fruits et les rayons de la lumière ? » (p. 11). Le peintre, sans doute, tel Alexandre Hollan, lorsqu’il dessine non plus les feuilles d’arbre, mais le vide qui les sépare. Mais seul le chorégraphe nous fait retourner physiquement dans un espace qui paraît inaugural. Si la chorégraphie est un art de l’espace, c’est un art de l’espace qui le révèle comme vide.
La grande force d’Elsa Ballanfat est de se défaire de toute rigidité. Elle sait combien il importe de distinguer entre l’opposition réelle qui repose sur un principe d’existence et l’opposition logique qui repose sur le principe de contradiction (de deux propositions contradictoires, si l’une est vraie, l’autre est fausse). Voilà qui conduit à considérer le vide et le plein non pas comme des entités abstraites, mais comme des puissances réelles en rivalité et se composant selon diverses guises, dans un jeu de force incessant. Il faut battre en brèche un dualisme logique et exclusif qui fait des ravages et montrer comment vide et plein tantôt se disjoignent, et tantôt se rejoignent comme le yin et le yang dans le diagramme du faîte suprême. Chaque membre du couple non seulement s’enlace à l’autre, mais ménage en lui une place pour son accueil.
Le livre se compose de dix-huit chapitres, aux titres explicites. La philosophie l’emporte d’abord et donne les bases autour d’Erwin Strauss, de Maldiney et de Heidegger. Les deux chapitres sur la sculpture et la danse chez Heidegger sont très éclairants. Puis viennent des chapitres bien sentis sur Merce Cunningham et Pina Bausch. Le chapitre 15 est particulièrement suggestif avec l’analyse de Café Müller, ce café d’une petite ville de la Ruhr, dans lequel Pina Bausch fut servante un temps pour remplacer son père et écouta sans préjugés, derrière son comptoir, les réponses fort diverses que ses clients donnaient aux questions de la vie. Voilà ce avec quoi elle voulut travailler par la mise entre parenthèses des espaces coutumiers et par l’ouverture d’un autre espace (on songe à l’inconscient de Freud, défini comme « l’autre scène ») : « Au vide correspond une suspension de ses idées, de ses préjugés. Il est donc à la fois une épochè de l’espace pour lui-même, mais aussi le critère par lequel la chorégraphe peut atteindre ce qu’elle cherche dans l’expérience de chacun » (p. 342).
Les derniers chapitres donnent des détails instructifs et passionnants sur les relations entre l’Occident, la Chine et le Japon sur ces questions. Parmi de nombreuses analyses, citons l’exemple du pont, chère à Heidegger. Le Dialogue avec la gravité d’Agamatsu nous rappelle que marcher le long d’une rivière ne permet de découvrir que son profil. Au contraire, marcher sur un pont nous met en situation de vis-à-vis. Aussi bien, commente l’auteure, le théâtre (et, en particulier, celui de la chorégraphie) est analogue au pont : il est fait pour rendre visible. Ou, plus exactement, il est fait pour « nous proposer un face-à-face avec ce que l’expérience commune nous empêche de voir dans la mesure où nous y sommes. Le théâtre nous ôte à l’espace pour nous le rendre visible : il en constitue l’expérience pure » (p. 422). Et, dans sa conclusion, Elsa Ballanfat reprend ce point en écrivant que « L’expérience esthétique d’une œuvre d’art reconduit à une expérience inaugurale, non en tant qu’elle la re-produit (et en cela elle existerait), mais en tant qu’elle la signale, la rend désirable, nous met en quête de l’Ouvert inapparent » (p. 424-425).
Maintenant, la difficulté est toujours d’articuler l’expérience sensible et l’expérience de la pensée conceptuelle, en comprenant comment elles s’intriquent, se relancent et s’approfondissent mutuellement. Et, en l’occurrence, il faut saluer le tour de force réalisé par Elsa Ballanfat, qui consiste à maintenir à la fois la phénoménalité du vide (le vide est rien et n’est pas rien) et sa conceptualisation (le vide est un outil qui permet de mémoriser, de signaler et de poursuivre une expérience).